SECONDE PARTIE – TECHNIQUES
BLZ
LE TRAIN-JOUET FRANÇAIS : ASPECTS TECHNIQUES ET
BREVETS D’INVENTION DEPOSES
ASPECTS TECHNIQUES DES TRAINS-JOUETS BLZ
- LOCOMOTIVE
BLZ DE TYPE 1B1
· I - 1B1 avec inverseur manuel
· II - 1B1 bicolore avec inverseur à distance
II-1 – INVERSION PAR COUPURE ET RETABLISSEMENT DU
COURANT
II-2 – INVERSION PAR CELLULE
REDRESSEUR
- LOCOMOTIVE
BLZ DE TYPE CC A CHASSIS AUTOMOTEURS EN ZAMAC
·
I - Restauration de la partie mécanique
·
II - Restauration de la partie
électrique
- LOCOMOTIVE BLZ DE TYPE CC A CHASSIS AUTOMOTEURS EN ACIER
·
I – Son achat et son histoire
·
II - Sa transformation pour fonctionner en courant alternatif
LOCOMOTIVE BLZ
DE TYPE 1B1
Rappelons que la locomotive BLZ
de type 1B1 a connu un succès important dès sa sortie en 1947. Cette locomotive
mesure
Comme on l’a déjà
mentionné dans la première partie consacrée aux brevets déposés par BLZ, la caisse est constituée
de deux demi-carrosseries presque identiques fixées l’une à l’autre par quatre
vis (deux sous les pantographes, deux sous le châssis) et par les traverses de
tamponnement. La couleur de la carrosserie était proposé dans les coloris
suivants : vert foncé, brun, chocolat et bicolore (vert clair pour le haut et vert
foncé pour le bas).
A noter que le modèle bicolore est le seul modèle équipé d’un dispositif
d’inversion à distance du sens de la marche (références catalogue 1001.t), les
autres modèles comportant un simple dispositif manuel à manette monté sur la
locomotive.
Le moteur très puissant, qui
peut accepté un courant continu ou (de préférence) un courant alternatif
jusqu’à 33 volts, permet d’entraîner sans problème et à vive allure la
locomotive même lorsque elle est attelée à plusieurs voitures et wagons,par
exemple au nombre de cinq à six ou d’avantage.
FONCTIONNEMENT ELECTRIQUE DE LA LOCOMOTIVE
Le moteur de cette
locomotive est un moteur universel du type classique moteur « série »
où le courant d’alimentation (suivant sa polarité), soit est transmis depuis
l’induit à l’inducteur bobiné, soit est transmis depuis l’inducteur bobiné à
l’induit, et retourne ensuite vers l’autre source. En d’autres termes,
inducteur et induit sont disposés l’un derrière l’autre.
Le schéma donné ci-après
illustre la conception générale de ce type de moteur et il est supposé
représenté la demi-carrosserie de la locomotive renfermant le moteur vue du
coté interne, cette locomotive étant posée à plat sur son coté droit et ayant
son extrémité avant qui est donc située à gauche sur le schéma (ou l’image
apparaissant ci-après) ; dans cette position, la manette du dispositif
d’inversion de marche se déplace dans un plan vertical de haut (pour contact
avec la borne C1) en bas (pour contact avec la borne C2)
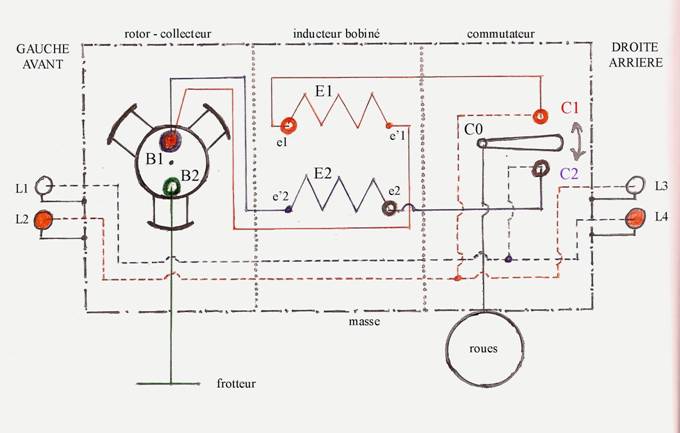
Pour consulter un schéma
agrandi cliquer ici
Le moteur est constitué de
droite à gauche des éléments constitutifs essentiels suivants :
1) un commutateur
d’inversion de marche où les bornes C1 et C2 sont reliées respectivement aux
bornes e1 et e2 de l’inducteur bobiné, le commutateur étant relié
électriquement par sa borne C0 aux rails de roulement ;
2) un inducteur bobiné
comportant deux enroulements E1 et E2 dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Ø
ils sont enroulés, tous les deux, dans le sens des aiguilles d’une
montre (environ 250 tours chacun),
Ø
l’enroulement E1 ou E2 est mis en service suivant que la manette du
commutateur est placée sur la borne C1 ou C2,
Ø
le courant d’alimentation passe du frotteur à la borne B2 (balai), au
collecteur, à l’induit, à la borne B1 (balai ; borne commune aux deux
enroulements E1 et E2), à l’inducteur bobiné, puis au commutateur et il
retourne ensuite aux deux rails de roulement via la masse et les roues,
Ø
suivant que la circulation du courant passe, après l’inducteur bobiné,
par la borne C1 ou C2, le moteur tourne dans un sens ou dans l’autre ; en
effet le sens du courant dans l’inducteur se trouve dans un sens ou dans un
sens inversé, tandis que dans l’induit le sens du courant n’est pas modifié par
la position de la manette du commutateur :
· la circulation du courant passe par la borne C1 : l’enroulement E1 est mis en service et le courant y circule de droite à gauche, de la borne e’1 (fin de l’enroulement) vers la position e1 (début de l’enroulement), le rotor tourne alors dans le sens des aiguilles d’une montre et le système d’engrenages entraîne la locomotive vers la gauche, c’est à dire en marche avant ; le circuit avant apparaît sur le schéma en traits pleins rouge ;
· la circulation du courant passe par la borne C2 : l’enroulement E2 est mis en service et le courant y circule de gauche à droite de la borne e’2 (début de l’enroulement) vers la position e2 (fin de l’enroulement), le rotor tourne alors dans le sens contraire de celui des aiguilles d’une montre et le système d’engrenages entraîne la locomotive vers la droite, c’est à dire en marche arrière ; le circuit arrière apparaît sur le schéma en traits pleins bleu.
3) un rotor-collecteur
comportant des pièces constitutives assez classiques, à savoir : un induit
triple en étoile, un collecteur plat comportant trois solides plaques en cuivre
qui supportent les balais en charbon (ces derniers étant pressés sur la surface
en rotation par des petits ressorts ; taille des charbons : diamètre
=
ECLAIRAGE
DE LA LOCOMOTIVE
L’éclairage de
Les faces avant et arrière
possèdent cependant d’autres trous pouvant servir à installer des lampes
complémentaires. Nous proposons ci-après un système d’éclairage composé des
quatre lampes L1 (face avant : lampe blanche, s’éclairant en marche
avant), L2 (face avant : lampe rouge, s’éclairant en marche arrière), L3
(face arrière : lampe blanche, s’éclairant en marche arrière) et L4 (face
arrière : lampe rouge, s’éclairant en marche avant).
Le courant pour l’éclairage
de la locomotive est prélevé comme indiqué ci-après.
1) Eclairage des lampes L1
(blanche) et L4 (rouge) correspondant à la marche avant : le culot de L1
et l’une des bornes de L4 sont connectés à la borne C2 du commutateur, les
autres bornes de ces lampes étant connectés à la masse.
2) Eclairage des lampes L3
(blanche) et L2 (rouge) correspondant à la marche arrière : le culot de L3
et l’une des bornes de L2 sont connectés à la borne C1 du commutateur, les
autres bornes de ces lampes étant connectés à la masse.
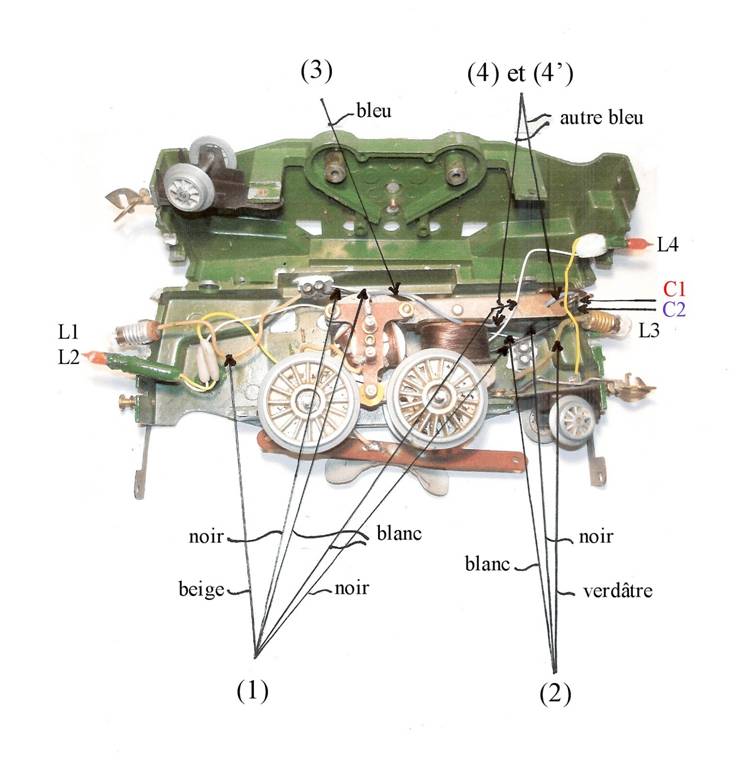
Légende :
(1) : ces fils relient
le culot de L1 avec la borne C2 (via fil beige, puis domino à gauche en dessus
induit, puis fil noir) et avec une borne de L4 (via fil blanc partant du domino
précité).
(2) : ces fils relient
le culot de L3 avec la borne C1 (via fil verdâtre, puis domino à droite
inducteur, puis fil noir) et avec une borne de L2 (via fil blanc partant du
domino précité).
(3) : ce fil bleu, à
deux conducteurs, relie la fin de l’enroulement E1 et le début de l’enroulement
E2 à la borne commune B1.
(4) : cet autre fil
bleu, à un conducteur, relie le début de l’enroulement E1 à la borne C1.
(
Pour revenir au sommaire cliquer ici
II – Dans un deuxième temps, on s’intéressera à la locomotive BLZ de
type 1B1 bicolore équipée d’un inverseur à
distance du sens de la marche :
II-1 – INVERSION PAR COUPURE ET RETABLISSEMENT DU COURANT :
A noter en
préambule qu’il n’est pas certain que le dispositif d’inversion à distance du
sens de la marche dont on va parler ci-après ait été monté à l’origine par
BLZ ; il est possible que pareil dispositif d’inversion ait été installé
postérieurement à BLZ par un artisan spécialisé dans le train-jouet en
utilisant des éléments de construction disponibles à l’époque dans le commerce.
Quoiqu’il en soit la motrice bicolore ainsi équipée accepte tant le courant
alternatif que le courant continu.
Plus précisément,
la locomotive est équipée d’un dispositif inverseur du type de celui décrit et
revendiqué par JEP dans son brevet n° 9 de 1943, le FR 980 738, c’est à dire un
dispositif dont la spécificité réside dans le fait que le sens de la marche
s’inverse par simple coupure et rétablissement du courant.
Le dispositif
monté dans la loco BLZ fonctionne donc selon le principe de l’interruption,
mais si les éléments de construction de l’inverseur chez BLZ (à savoir :
électro-aimant distinct de l’inducteur bobiné ; attirant une palette
mobile ; laquelle palette coopérant avec un doigt d’inversion rappelé par
ressort ; ce doigt actionnant un commutateur) sont dans leur conception
assez proches de ceux de JEP, on peut noter par contre des différences
sensibles aux niveaux de leur forme, leur agencement et leur montage électrique
(notamment l’électro-aimant chez BLZ est monté en parallèle avec les deux
enroulements de l’inducteur).
Si le dispositif a
été monté à l’origine par BLZ, il y a lieu de penser que ce n’est pas le brevet
de JEP qui est à l’origine de ces différences (qui auraient pu être apportées
par BLZ pour tenter de s’écarter de la technologie de JEP) car, au moment de la
mise en place du dispositif dans sa loco, BLZ ne connaissait probablement pas
le brevet de JEP qui a été publié le 17 mai 1951, année de la disparition de
BLZ.
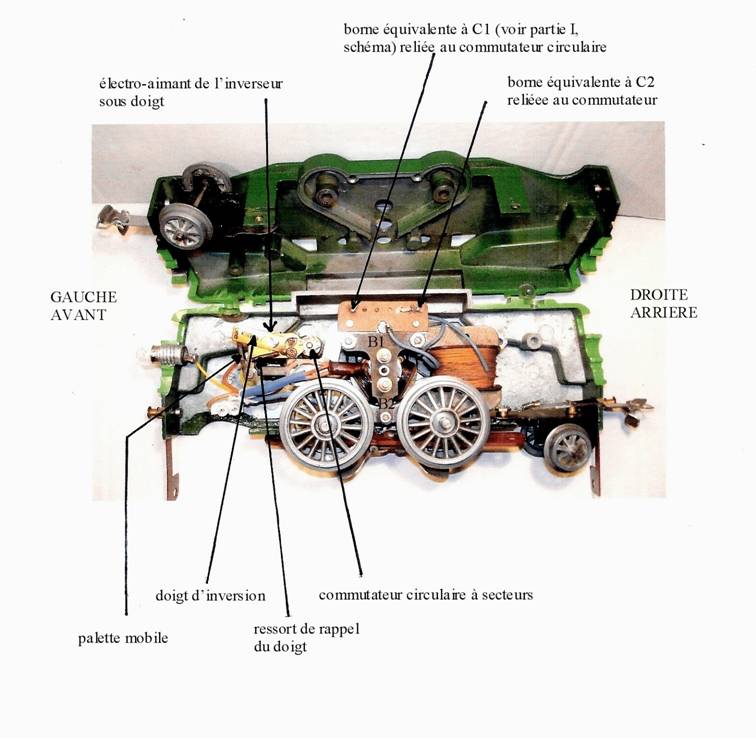
Pour consulter une image agrandie sans légende cliquer ici

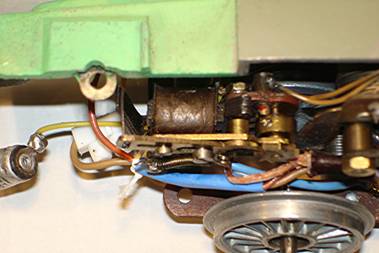
dispositif inverseur vu
« en élévation » dispositif
inverseur vu de dessus
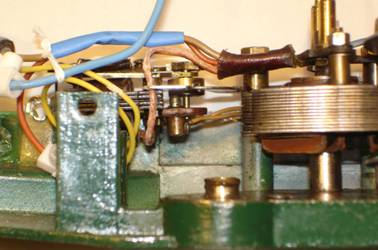
dispositif inverseur vu de
dessous
Pour revenir au sommaire cliquer ici
II-2 – INVERSION PAR CELLULE REDRESSEUR :
Il est quasiment certain
qu’un dispositif d’inversion à distance du sens de la marche par cellule
redresseur a été installé, à un moment ou un autre, par BLZ dans sa motrice
bicolore, laquelle fonctionnant alors uniquement sous courant continu. Plus
précisément, le moteur de cette locomotive est équipé d’une cellule « oxymétal ». On reparlera de
l’inversion de marche par cellule oxymétal lors de la description, donnée
ci-après, de la locomotive BLZ de type CC à châssis automoteurs en acier.
L’image donnée ci-après
montre l’intérieur d’une motrice bicolore dont le moteur est équipé d’une
cellule oxymétal ; cette cellule comporte, dans le cas de la locomotive
BLZ de type 1B1, 2 « feuilles » métalliques et 3 pattes (ou bornes)
de connexion et elle porte la marque « WESTINGHOUSE WESTALITE ».
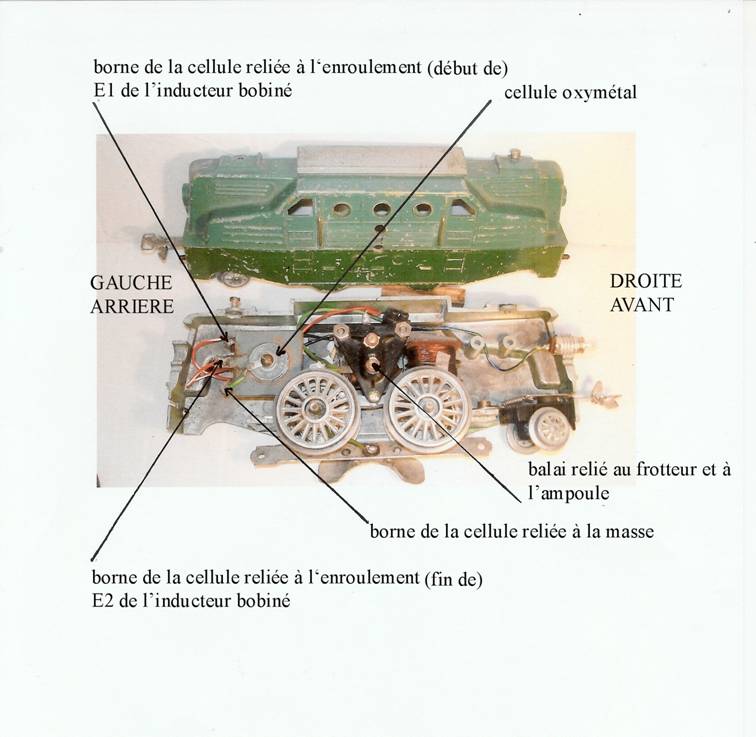
Pour consulter une image agrandie sans légende cliquer ici

dispositif inverseur par
cellule oxymétal vu de dessous la locomotive
Pour revenir au sommaire cliquer ici
----------------------------------------------
LOCOMOTIVE BLZ DE TYPE CC A
CHASSIS AUTOMOTEURS EN ZAMAC
Rappelons que la locomotive
BLZ de type CC est en fait de type 1BB1. Elle représente un modèle très rare et
imposant à 12 roues, 2 moteurs (cette motorisation a existé d’ailleurs en deux
versions) et 8 roues motrices ; le modèle réel dont s’est inspiré BLZ
consiste ici dans le prototype CC 6001 de
Ci-dessous le dessin de
cette locomotive, extrait du catalogue de 1946-1947 établi par les « ATELIERS
BLZ » :

La locomotive est équipée de
deux châssis automoteurs, ayant chacun deux essieux moteurs ; rappelons que la
description détaillée du châssis automoteur peut être trouvée dans brevet français
n° 5 de BLZ, le FR 967 056(A) de 1948, dont le texte intégral est accessible
dans la première partie de ce site consacrée aux brevets déposés par la firme
BLZ.
L’auteur de ce site va
rapporter dans les paragraphes suivants l’histoire de la restauration réussie
d’un exemplaire de cette locomotive achetée en 2005 chez un
« antiquaire » de jouets anciens pour quelques centaines d’euros.
I - Restauration de la
partie mécanique :
La locomotive avait une robe vert sombre en état d’usage
comme l’on dit, mais sous la « bête », c’était l’horreur. Je n’ai
malheureusement pas fait de photographie et je vais tenter de décrire dans les
lignes qui suivent, avec des mots et l’appui d’un schéma, les dégâts provoqués
par le cancer du zamac. Bien sûr, les moteurs ne fonctionnaient plus et les
roues étaient bloquées.
Les longerons châssis droite et gauche étaient
déformés et leur allure s’éloignait pas mal de la ligne droite, surtout vers
les extrémités avant et arrière, et cela à un point tel que les essieux
porteurs d’extrémités de la locomotive sortaient des bossages creux installés
(à la fabrication par moulage) dans la face interne des longerons. Certains de
ces bossages étaient d’ailleurs complètement fissurés et demandaient à être
refaits.
La figure qui est donnée ci-après
correspond à la figure 1 du brevet français n° 5 de BLZ, le FR 967 056(A) de
1948 (qui a été
agrandie) et elle va aider à la bonne compréhension des interventions :
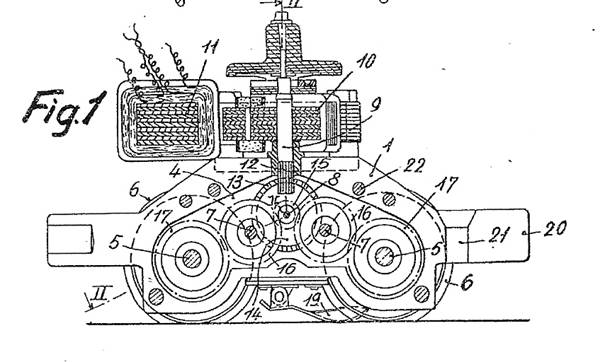
Les deux bogies automoteurs étaient eux aussi très
déformés : le zamac « en gonflant » sous l’effet de son cancer
avait modifié les dimensions de chaque flasque symétrique (demi-coquille
correpondant à la pièce 1) constitutif, par assemblage, de chaque
châssis tant dans le sens de la longueur que dans le sens de la hauteur :
-
dans le sens de la longueur, une différence allant environ de 0,2 à
-
dans le sens de la hauteur, le toit des flasques supportant le moteur
électrique était remonté d’environ
-
les deux essieux moteurs (pièces 5) n’étaient plus parallèles,
-
certains des tourillons (de haut en bas, pièces 8 et 7)
ont bougé et certaines des roues dentées intermédiaires (pièces 13, 14-15 et
16) montées sur ces tourillons ne tournaient plus librement et ne pouvaient
plus entraîner les roues dentées terminales (pièces 17) clavetés sur les
essieux (pièces 5).
De plus pour l’un des châssis automoteurs, l’un des
rebords en zamac dans lequel se visse les pattes de fixation du moteur
électrique sur le toit du châssis était sérieusement ébréché, avec comme
conséquence une probable perte de la stabilité horizontale de l’ensemble
constitué par l’inducteur et son rotor (pièce 10) le jour où le moteur
fonctionnerait.
La locomotive a été complètement démontée et la
restauration entreprise, qui a demandé une cinquantaine d’heures, a consisté
dans la réalisation des principales étapes suivantes ; les étapes 1 à 5
étaient importantes, non seulement pour mettre fin au cancer du zamac, mais
encore pour redonner de bonnes propriétés mécaniques aux flasques symétriques
constitutifs des bogies afin qu’ils puissent supporter sans dommage
complémentaire les opérations invasives de perçage entreprises dans l’étape 6 :
1) arrêt du cancer par nettoyage intense (des
surfaces des pièces en zamac au moyen de papier de verre fin) et trempage les
unes après les autres (ou traitement au pinceau quand le trempage n’était pas
possible) de toutes les pièces en zamac dans la quantité voulue de colle à base
de cyanoacrylate liquide, par exemple à l’aide de la colle « SuperGlue
liquide de Loctite », pendant une durée de 10 minutes, temps nécessaire
pour que la colle liquide pénètre et migre profondément par capillarité à
l’intérieur des fissures du zamac ;
2) réparation, sur le toit du châssis automoteur
concerné, du rebord servant à recevoir les pattes de fixation du moteur
électrique avec de la pâte bicomposante durcissable à température ambiante, par
exemple celle vendue par Pattex ;
3) « ré-usinage », en utilisant une scie à
lame fine (essentiellement pour raccourcir plus ou moins les extrémités (20)
des châssis), une mini-perceuse équipée d’accessoires pour meuler et/ou poncer
et du papier de verre fin (essentiellement pour redonner d’une part une bonne
planéité à toutes les surfaces internes et externes des flasques constitutifs
de chaque bogie par assemblage et, d’autre part, une forme convenable au rebord
du toit du châssis) ;
4) pose de plusieurs couches de peinture noire
satinée sur toutes les surfaces en contact permanent avec l’air : (i) les
deux faces de chaque longeron et (2i) toutes les surfaces externes des flasques
ou demi-coquilles constitutifs de chaque bogie ;
5) nouveau traitement de toutes les surfaces internes
des flasques constitutifs de chaque bogie (non mises en peinture) à l’aide d’un
pinceau enduit de colle liquide au cyanoacrylate ;
6) étape la plus longue et difficile concernant
« la remise en état » du système d’engrenages entraînant les deux
essieux :
Ø engrenages intermédiaires et
essieux :
principales interventions : (i) bouchage avec la pâte bicomposante Pattex
de tous les trous « ayant sensiblement bougé » servant de passage
tant aux essieux (pièces 5) qu’à des tourillons (ou axes de) (pièces 8
et 7) sur lesquels sont montées des roues dentées ; (2i) après
durcissement pendant 24 heures, perçage de nouveaux trous pour ces essieux et
axes, en indiquant que le choix des points de perçage a chaque fois été
déterminé expérimentalement par application de la technique du tâtonnement
[perçage, puis installation/fixation axes, puis montage roues dentées et essai
de rotation et d’entraînement des autres roues dentées terminales (pièces 17)
et des essieux ; si mauvais résultat, le cycle perçage-installation
axes-montage roues dentées-essai est recommençé autant de fois que cela est
nécessaire pour obtenir un bon fonctionnement] ;
Ø pignon d’amont (pièce 12),
commandant le système d’engrenages entraînant les essieux : il a été descendu
sur chaque bogie d’environ
7) renforcement de plusieurs bossages creux
installés sur les faces internes des longerons avec de la pâte bicomposante
Pattex et mise (ou remise) en peinture.
A l’issue de la restauration ainsi décrite, il était
redevenu possible d’entraîner les essieux de chaque châssis à partir de la
rotation de l’arbre vertical du rotor.
Trois ans plus tard, en 2008, la locomotive a été
re-testée et il a été nécessaire, sur l’un des bogies automoteurs, de refaire
le scellement de l’axe du nouveau pignon d’amont (pièce 12) dans
l’intérieur de l’arbre vertical du rotor.
Cinq ans plus tard en 2010, tout continuait à bien
fonctionner.
Pour revenir au sommaire cliquer ici
II - Restauration de la
partie électrique :
On donnera ci-après le
schéma illustrant le montage électrique de la locomotive en état de fonctionnement,
tel qu’il se présente à l’issues des phases de restaurations mécanique et
électrique.
Une restauration électrique
a donc également été nécessaire. Au lendemain de l’achat et du démontage de
1) la locomotive ne
comportait aucun dispositif d’inversion du sens de la marche par commande
manuelle ;
2) la locomotive portait sur
la plage arrière de l’un des châssis automoteurs le reste d’un possible
dispositif d’inversion du sens de la marche télécommandée (la légende du dessin
montré ci-avant parle de « 2 moteurs
télécommande ») consistant dans une cellule redresseur
(comportant 4 « feuilles » métalliques et 5 pattes de connexion) qui
n’était branchée à rien du tout, ayant les dimensions suivantes :
carré de
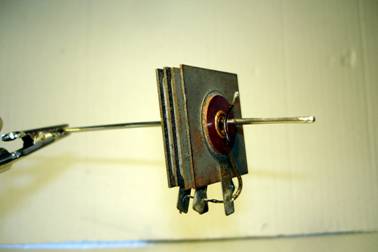
vue de la cellule redresseur
résiduel
Dernière minute : C’est en consultant le catalogue de BLZ Belgique
(*) que l’on trouve, à la page 3, des informations sur le dispositif d’inversion
du sens de la marche. L’image ci-contre est un extrait de cette page 3. On peut lire que la locomotive est munie d’un
système d’inversion par cellule « oxymétal »
et chaque moteur est équipé d’une cellule. On doit comprendre que la cellule redresseur
montrée ci dessus n’est autre que l’une des cellules « oxymétal » en question. On est donc en présence d’un système d’inversion
par cellule redresseur et non par survoltage -------------------------------------------------------------- (*) BLZ Belgique :
cette
entité est née en 1951 après la séparation des associés BOURDEAUX, LHEURE
et ZEDDA et elle a délocalisé en Belgique l’exploitation de la gamme
« 0 » (adresse : 56 rue de Stassart, proche de la porte de
Namur, BRUXELLES)
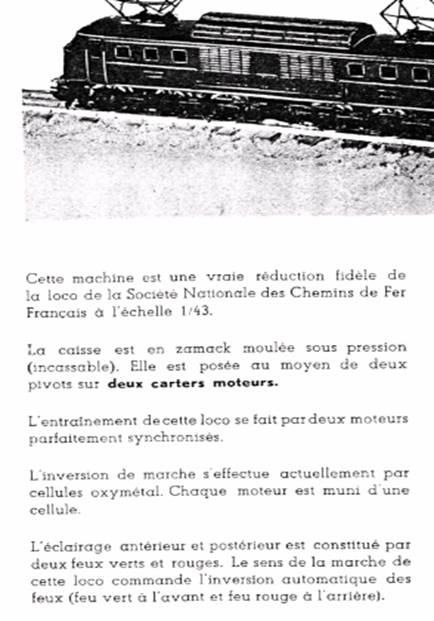
BLZ est le
troisième fabricant de trains-jouets, après JEP en 1935 (cf. son brevet n° 8)
et LR en 1936 (cf. son brevet n° 6), à avoir fait appel à un redresseur pour
commander à distance le sens de la marche. Le principe de fonctionnement du
système était alors le suivant : dans le cas d’un fonctionnement en
courant continu, le dispositif d’inversion ne contenait qu’un inverseur de
polarité ; dans le cas d’un fonctionnement en courant alternatif, il
comportait deux systèmes redresseurs distincts, l’un situé à la sortie du
transformateur et l’autre monté dans la locomotive. Dans la locomotive, la
cellule « oxymétal » de chaque moteur déterminait le sens de la
marche par la sélection de l’un ou l’autre bobinage de l’inducteur.
Dans le cadre de la
restauration entreprise, il a été choisi une solution de simplicité consistant
à monter un dispositif d’inversion du sens de la marche par commande
manuelle ;
3) le montage électrique
correspondait à celui de deux moteurs « série », installés en
parallèle l’un par rapport à l’autre ;
4) il y avait une erreur
dans le montage consistant dans la mise en relation du circuit de marche avant
d’un moteur avec le circuit marche arrière de l’autre moteur.
Le schéma/dessin donné ci-après
illustre la conception générale de la locomotive CC de BLZ après
restaurations ; il représente deux vues :
-
dans la partie supérieure du dessin, il s’agit d’une vue de dessus de
l’ensemble de la locomotive qui montre la disposition des différents organes
constitutifs des deux châssis automoteurs et la circuiterie électrique
installée,
-
dans la partie inférieure du dessin, il s’agit de la vue intérieure de
la carrosserie de la locomotive après son renversement.
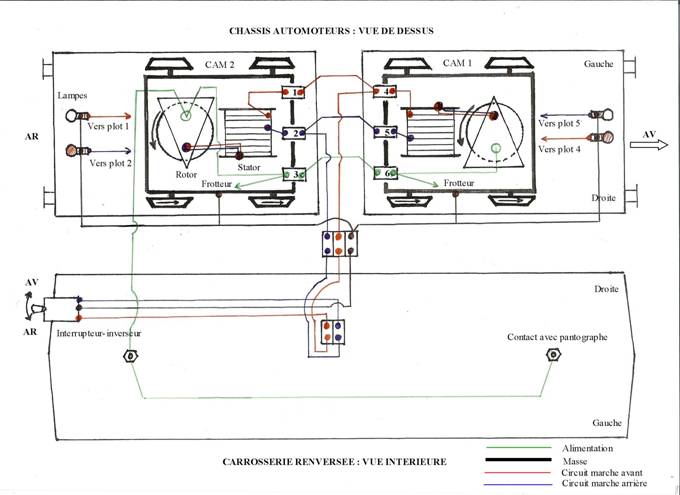
Pour consulter un schéma
agrandi cliquer ici
Pour consulter une image
réelle de la locomotive et de sa carrosserie disposées comme sur le dessin :
Pour revenir au sommaire cliquer ici
----------------------------------------------
LOCOMOTIVE BLZ DE TYPE CC A
CHASSIS AUTOMOTEURS EN ACIER
I
- Son achat et son histoire :
En 2005, peu après l’achat
de la locomotive BLZ CC 6001 à châssis automoteurs en zamac dont la
restauration a été décrite ci-avant, le même « antiquaire » de jouets
anciens me contacte pour me dire qu’il met en vente une autre BLZ CC 6001, qui
cette fois est en parfait état de marche et, de plus, a une histoire tout à
fait intéressante.
Selon ledit antiquaire :
« ……… cette locomotive
aurait été fabriquée en quelques exemplaires seulement à l’occasion, peut-être,
d’un événement en relation avec la vie de
………… cette locomotive a été
« customisée » après sa fabrication : les pantographes ont été
modifiés pour les rendre plus proches de la réalité ; les cabines de
conduite ont été équipées d’un vitrage en plastique avec hublots ; l’une
des cabines possède en plus un tableau de bord très réaliste, un éclairage
intérieur et un conducteur en position debout avec les mains posées sur le
cercle de commande des moteurs ; une main-courante a été installée sur la
carrosserie en dessous du vitrage ; et la carrosserie a reçu, aux bons
endroits, les marques d’identification du prototype CC 6001 de
Pour consulter une image de la face avant de la
locomotive CC 6001 à châssis automoteurs en acier, « customisée »
comme indiqué ci-avant :
………... cette locomotive
aurait été présentée à une ou plusieurs reprise(s) ( ?) aux visiteurs du
musée français du chemin de fer de MULHOUSE vers la mi 1985 ou 1986 ;
………….cette locomotive est mise en vente à un prix
raisonnable et destinée à un collectionneur qui saurait la conserver en bon
état de marche et accepterait de la prêter au musée précité, si une demande
était faite dans ce sens ……… ».
La vente a eu lieu
rapidement.
Il convient de compléter la description de la
locomotive achetée en indiquant encore ce qui suit :
Ø
Cette locomotive était (et est) toujours, comme
Ø
S’agissant des châssis automoteurs, ils sont caractérisés en ce que le
système des engrenages de transmission, interposé entre le rotor et les
essieux, est logé maintenant :
-
non plus dans un carter fermé, presque étanche, formé par deux flasques
symétriques en zamac parfaitement jointifs,
-
mais dans un châssis ouvert formé par deux plaques d’acier
parallèles, d’où l’appellation de « châssis automoteurs en
acier » :
Images (coté et face avant) montrant un châssis
automoteur traditionnel en zamac :
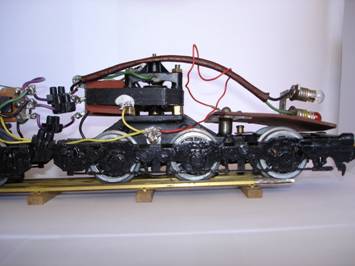
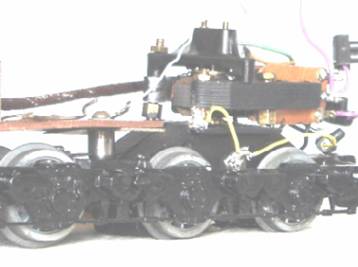
Images (coté et face avant)
montrant un châssis automoteur en acier :
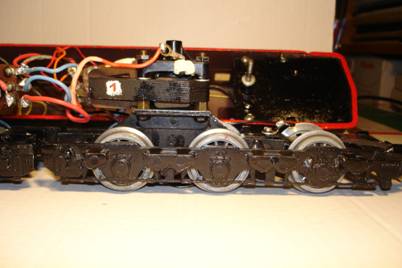

La question qui se pose est
celle de savoir qui a conçu et fabriqué, et à quelle date, ce type de châssis
automoteur en acier ?
QUI :
Il y a lieu de penser que la
fabrication de châssis ouverts formé par deux plaques d’acier parallèles n’est
pas le fait de BLZ dont une partie essentielle de son image de firme novatrice
reposait sur la conception (protégée par brevets) et la mise en œuvre
industrielle pour ses locomotives de bogies où le système d’engrenages était à
l’abri dans un carter presque étanche et à graissage permanent.
Il est fort probable que les
châssis automoteurs en acier ont été réalisés postérieurement à la
disparition de BLZ par une entité (ayant ou non une dimension industrielle) qui
reste à déterminer.
Plusieurs annonces de ventes
aux enchères, publiées depuis un certain temps sur Internet, présentent des
locomotives BLZ CC 6001 équipées de bogies avec roues et moteurs FOURNEREAU.
Selon Jean-Claude ZEDDA (contact établi avec ce
dernier dans le cadre du présente site) - fils d’Aldo ZEDDA, l’inventeur
notamment des bogies des CC à carter étanche et graissage permanent et
principal dirigeant de la firme BLZ - il est tout à fait possible que la firme FOURNEREAU
soit intervenue pour sauver des CC 6001 d’origine au châssis dégradé par le
« cancer » du zamac, en fournissant à tel ou tel demandeur des bogies
de remplacement en acier. Cette restauration peut aussi avoir été réalisée par
des artisans spécialisés dans le train-jouet.
Toute
possible information qu’un lecteur de ces lignes posséderait sur le(s)
fabricant(s) des châssis automoteurs en acier des CC, sera la bienvenue.
QUAND :
Probablement après la disparition de BLZ en 1951, et
plus précisément encore après la fermeture vers 1954 de BLZ Belgique, héritière
de la fabrication de la gamme « 0 ». Le remplacement des bogies
automoteurs en zamac par des bogies en acier, qui pourraient avoir été fournis
par la firme FOURNEREAU et/ou des artisans spécialisés, a pu se dérouler au
coup par coup sur une longue période.
Jean-Claude ZEDDA a gardé le souvenir qu’une série des
machines CC à bogies en zamac a bien été livrée à
Ø
Par ailleurs, pour fonctionner, la machine CC 6001 à bogie en acier
achetée devait impérativement être alimentée en courant continu ; c’est probablement un ancien
propriétaire (de préférence au transformateur) qui a réalisé le montage
électrique approprié (faisant appel notamment à l’installation de diodes sur
les circuits de marches avant et arrière) permettant pareil fonctionnement ;
l’inversion du sens de la marche devait se faire en jouant simplement sur la
polarité de la source d’alimentation ; à noter qu’un commutateur à deux
positions était inséré (venu probablement de la fabrication d’origine ?)
dans le toit de la carcasse de la locomotive, mais il n’avait aucune
fonctionnalité dans le montage en courant continu.
Le schéma/dessin donné
ci-après illustre la conception générale de cette locomotive à châssis
automoteurs en acier fonctionnant sous courant continu ; cette locomotive
avait la particularité de posséder des moteurs où, dans chacun d’eux,
l’inducteur doublement bobiné et l’induit étaient montés en parallèle, c'est-à-dire que l’on était en présence d’un moteur de
type en dérivation :
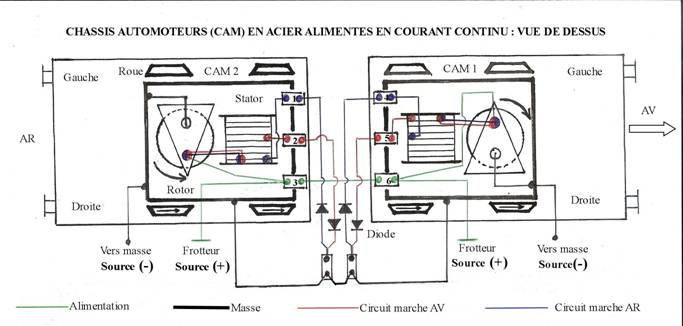
Pour consulter un schéma
agrandi cliquer ici
Pour revenir au sommaire cliquer ici
II - Sa transformation pour fonctionner en courant alternatif :
Ayant observé que
l’inducteur doublement bobiné de chaque châssis automoteur en acier CHAUFFAIT
ANORMALEMENT dès la fin de la première minute de fonctionnement sous courant continu
et cela, même en restant sous une faible tension d’alimentation, de l’ordre de
5 à 12 volts, la décision a été prise, pour assurer la pérennité des circuits,
de modifier le montage en dérivation des électromoteurs pour revenir à des moteurs
de type série sans diode alimentés en courant alternatif, du type de
ceux équipant
Le schéma/dessin donné
ci-après illustre donc la conception générale de la locomotive CC 6001 achetée,
à châssis
automoteurs en acier, et transformée pour fonctionner en courant alternatif ; il
représente deux vues :
- dans la partie supérieure du
dessin, il s’agit d’une vue de dessus de l’ensemble de la locomotive qui montre
la disposition des différents organes constitutifs des deux châssis automoteurs
et la circuiterie électrique installée pour la marche en courant alternatif, et
- dans la partie inférieure du dessin, il s’agit de la vue intérieure de la carrosserie de la locomotive après son renversement montrant notamment le circuit des lampes.
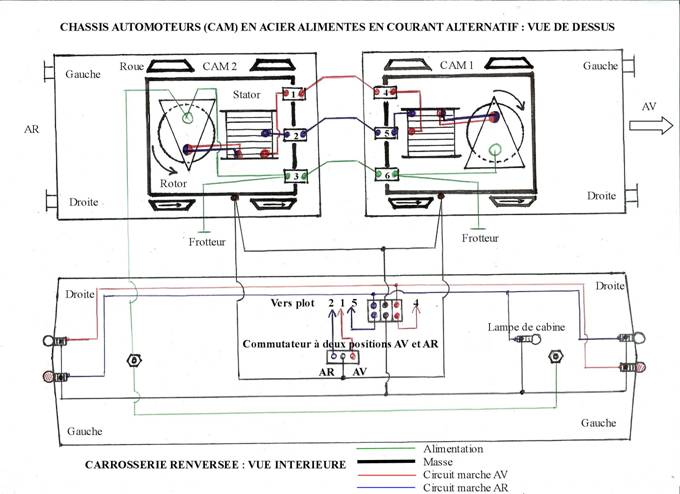
Pour consulter un schéma
agrandi cliquer ici
Pour consulter une image
réelle de la locomotive et de sa carrosserie disposées comme sur le dessin :
Ci-dessous image du
commutateur à deux positions inséré dans le toit de la carcasse de la
locomotive (venu probablement de la fabrication d’origine ?) :

Pour revenir au sommaire cliquer ici
……………………………………………………………. à suivre
***************************************************
© Février 2010 – Mars 2010 –
Mai 2010 – Janvier 2011